Penser l’adaptation des services pour les jeunes de 12 à 25 ans dans le contexte du COVID-19
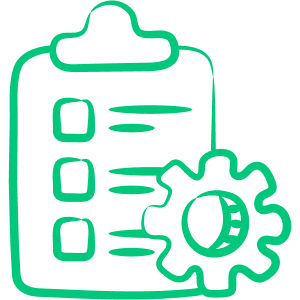
Contexte du projet
de recherche

La pandémie de COVID-19 a profondément bouleversé les pratiques dans les services jeunesse, mettant à l’épreuve les intervenant·es et les institutions. Ce projet de recherche mené par Emmanuelle Khoury (Université de Montréal) en collaboration avec Martin Goyette (ENAP)s’inscrit dans le cadre de la programmation du Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ). Il vise à mieux comprendre les effets de la crise sanitaire sur les jeunes de 12 à 25 ans et sur les intervenants·es qui les accompagnent.
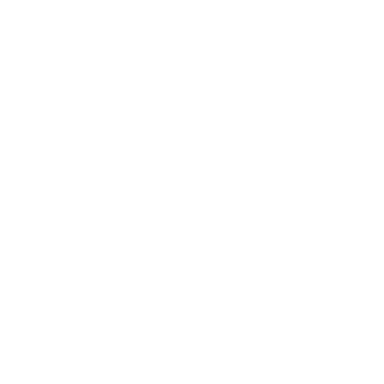
Questions de recherche
Quels ont été les changements dans les besoins des jeunes durant la première et deuxième vague de la pandémie, selon les intervenant·e·s jeunesse ?
Quelles leçons peut-on tirer des expériences vécues des intervenant·e·s jeunesse à Montréal, au Québec, afin d’adapter les services jeunesse et transformer les pratiques pour mieux répondre aux besoins des jeunes et de leurs familles en temps de crise ou de catastrophe ?
Quels sont les besoins des intervenant·e·s jeunesse en matière de soutien organisationnel et de formation afin de mieux faire face à un contexte en constante évolution ?
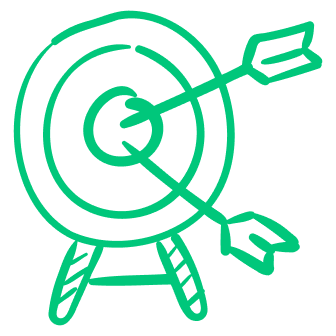
Nos objectifs
- Comprendre les représentations sociales des professionnel·les dans les services jeunesse en lien avec la COVID-19 et les mesures de santé publique.
- Documenter les pratiques d’adaptation et les innovations mises en place pour répondre aux besoins des jeunes pour en tirer des apprentissages
- Mieux saisir les besoins de formation exprimés par les intervenant·es.
Nos activités de recherche

Étape 1
Recension des écrits rapide sur l’intervention auprès des jeunes en temps de crise

Étape 2
Recrutement des participants dans deux CIUSSS de la ville de Montréal.

Étape 3
Groupe de discussion avec 31 personnes intervenantes jeunesse

Étape 4
Publication de deux articles que vous pouvez retrouver ici:
Telehealth for Social Interventions With Adolescents and Young Adults: Diverse Perspectives
Working with Youth During the COVID-19 Pandemic: Adaptations and Insights from Youth Workers
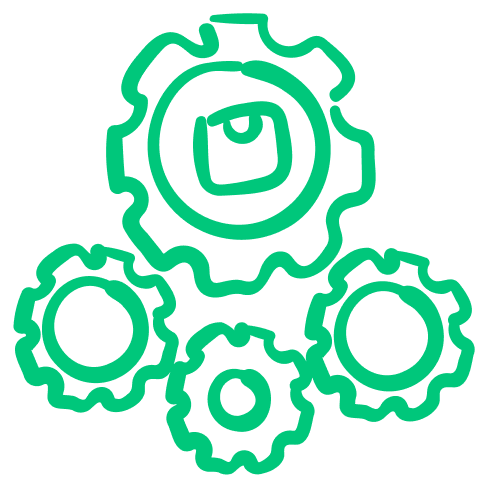
Comment nousfaisons cela ?
Des groupes de discussion (par Zoom) avec des intervenant·es issu·es de différents milieux jeunesse ont été organisés (n=31). Les échanges portaient sur les adaptations apportées aux pratiques professionnelles durant la première vague et le début de la deuxième vague de la pandémie, les défis rencontrés et les stratégies innovantes développées, leurs perceptions des changements dans les besoins des adolescent·e·s, des jeunes adultes et des familles, ainsi que leurs propres besoins en formation et en soutien. Ces discussions ont été enregistrées et analysées dans une démarche qualitative. Un questionnaire qualitatif en ligne a également été diffusé à travers l’ensemble de la province du Québec mais le taux de réponse n’était pas suffisant pour apporter des données significatives.
Pourquoi c'est important
La participation des intervenant·es permet de :
- Mieux comprendre les réalités de terrain.
- Développer des pistes d’action concrètes et adaptées.
- Soutenir l’implantation et l’évolution des services d’Aire ouverte en tant qu’organisations résilientes.
Ce qu’on en retire
Les échanges avec les intervenants·es ont permis de tirer plusieurs constats importants :
- Des pratiques innovantes ont émergé pour maintenir le lien avec les jeunes et garantir une continuité de service malgré la distanciation, comme l’utilisation accrue des technologies, l’adaptation des suivis et la création d’espaces d’écoute plus flexibles.
- Une préférence pour les services en personnes qui est plus favorable à la création d’un lien de confiance, à la lecture et compréhension des communications non verbale, au maintien de la confidentialité et à un meilleur engagement.
- Un besoin fort de soutien et de formation a été exprimé, notamment en lien avec la santé mentale, les outils numériques et l’adaptation des approches d’intervention.
- La pandémie a révélé les limites structurelles des services jeunesse actuels, mais aussi leur capacité à se transformer rapidement.
- Le bien-être des intervenant·es est apparu comme un enjeu central, soulignant l’importance de penser des conditions de travail plus soutenantes.
Piste d'amélioration:
- Offrir la télésanté en option complémentaire, non exclusive.
- S’assurer d’un accès équitable à la technologie et un espace adapté.
- Fournir une formation et un soutien adéquate aux intervenant·e·s.
- Établir des normes éthiques claires pour les pratiques à distance.

